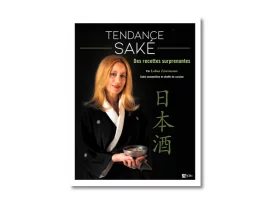Plongez dans la suite de l’univers fascinant du saké japonais, une boisson traditionnelle riche en histoire et en saveurs. Ce guide explore l’importance du polissage du riz dans la fabrication des saké et les différents types de saké que vous pouvez retrouver.
Le polissage du riz : l’étape cruciale dans la fabrication du saké japonais
Le processus de polissage du riz est l’un des aspects les plus critiques et les plus déterminants dans la création du véritable saké japonais. Cette étape joue un rôle majeur dans la définition du profil de goût et de la qualité du saké.
L’importance du polissage du riz
Le polissage du riz, ou « seimai », implique la suppression des couches extérieures du grain de riz. Ces couches externes contiennent la plupart des protéines et des lipides qui peuvent donner au saké des saveurs indésirables et une texture moins raffinée. L’objectif est d’atteindre le cœur du grain de riz, riche en amidon, qui est essentiel pour une fermentation pure et la création d’un saké de qualité supérieure.
Polissage du riz et qualité du saké
Le degré de polissage du riz est exprimé en pourcentage, qui indique la quantité restante du grain de riz après le polissage. Par exemple, un riz poli à 60 % signifie que 40 % de la couche externe a été retirée.
Plus le riz est poli, plus le saké qui en résulte est léger, doux et aromatique. Un polissage moins intense produit un saké avec des saveurs plus robustes et terreuses.
Les différentes catégories de saké, telles que « Ginjo », et « Daiginjo », ont des exigences spécifiques en termes de taux de polissage.
Une étape délicate pour les maîtres brasseurs
Le polissage du riz est un processus délicat qui nécessite précision et attention. Il est souvent effectué lentement pour éviter de surchauffer et d’endommager les grains de riz.
Bien que la technologie moderne ait apporté des améliorations dans le processus de polissage, de nombreux producteurs de saké continuent de valoriser les méthodes traditionnelles, considérant le polissage comme un art en soi.
Différents types de riz sont utilisés pour la fabrication du saké, chacun ayant ses propres caractéristiques de polissage en fonction du taux d’amidon contenu en son cœur. Certains grains sont plus adaptés à un polissage élevé, tandis que d’autres offrent des qualités optimales avec un polissage plus modéré.
Bien entendu, les autres étapes de fabrication du saké comme la cuisson ou la fermentation ont aussi un rôle à jouer dans la qualité du nihonshu obtenu. Néanmoins, c’est le degré de polissage du riz qui détermine le type de saké que vous allez déguster.
Les différents types de sakés japonais

Junmai : L’authenticité du saké traditionnel
La catégorie « Junmai » représente le saké dans sa forme la plus pure, sans aucun ajout d’alcool. Suite à une pénurie de riz après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a autorisé l’ajout d’alcool de distillation dans le saké pour augmenter la production.
Cette pratique demeure encore aujourd’hui, au détriment de la qualité du produit final, d’autant que la réglementation autorise la présence de cet alcool étranger jusqu’à 25 % du produit final, voire plus pour certains « Futsushu » (sakés de table) nommés « Sanzoshu » (« triple saké » nommés ainsi, car on triple le volume d’origine par ajout extérieur).
Il existe toutefois des brasseurs qui exploitent cette possibilité avec intelligence pour réaliser des sakés originaux et très bons, mais ils restent à la marge. Cette pratique permet surtout de fournir un produit de masse à prix très réduit, à l’image de nos « vins de table » français.
Cependant, les sakés « Junmai », à l’image du saké junmai Asamurasaki, sont restés fidèles à la tradition, offrant un goût riche et authentique, uniquement issu de la fermentation du riz, sans alcool ajouté.
Genshu : le saké le plus « pur »
Les « Genshu » sont des sakés embouteillés directement à la sortie du fût, sans dilution, offrant ainsi une saveur robuste avec un taux d’alcool généralement plus élevé. Ces sakés captivent par leur intensité et leur caractère naturel.
Ginjo et Daiginjo : des sakés brassés à partir du cœur du riz
Ces appellations, « Ginjo » et « Daiginjo », se réfèrent au degré de polissage du riz. Un polissage plus poussé élimine les cosses extérieures des grains, rendant le saké plus doux et moins amer.
Un saké « Ginjo » requiert un polissage d’au moins 60 %, tandis que le « Daiginjo » va au-delà, pour un saké encore plus raffiné.
Cette variation du taux de polissage ne permet pas de différencier qualitativement les sakés, même si elles vont logiquement avoir un effet sur le prix (plus le riz est poli, plus il en faut pour produire un litre de breuvage). C’est surtout la notion de douceur de la boisson finale qui est concernée.
Honjozo : le compromis entre la qualité et le prix
Les sakés « Honjozo » sont légèrement « coupés » avec de l’alcool ajouté, mais respectent une norme de qualité avec un riz poli au moins à 70 %. Ils représentent un équilibre entre qualité et accessibilité, avec une augmentation des arômes grâce à l’ajout d’éthanol.
Nigori & Namasaké : des saveurs uniques et laiteuses
Le « Nigori » et le « Namasaké » offrent une expérience unique avec une texture laiteuse et des saveurs plus sucrées. Le « Namasaké » est non pasteurisé à la sortie de la cuve, tandis que le « Nigori » n'est presque pas filtré et inclut des résidus de riz et de koji.
Le plus souvent servies fraîches, ces boissons sont plus sucrées que la moyenne et possèdent souvent des goûts de yaourt étonnants.
Tokubetsu : le saké « spécial »
« Tokubetsu », signifiant « spécial », est une appellation utilisée pour les sakés « Junmai » et « Honjozo » qui ont bénéficié d’un traitement particulier, comme un polissage du riz plus poussé ou un processus de fermentation unique.
Koshu : les sakés vieillis
Si notre culture du vin tend à faire vieillir nos flacons, cette approche n’est pas très courante au Japon pour le saké. En effet, en vieillissant, le saké tend à « madériser », lui donnant des caractéristiques fréquemment décevantes. Par voie de conséquence, les Japonais ont l’habitude de ne pas garder leurs bouteilles très longtemps et donc de consommer leur saké dans l’année.
Pourtant, il existe quelques brasseurs, probablement séduits par l’approche viticole, qui se sont intéressés au processus de vieillissement des nihonshu et qui les préparent dès la fermentation initiale pour offrir un résultat adapté à la garde.
On nomme donc cette dernière catégorie « Koshu ». Souvent riche en bouche, elle mérite le détour même si, effectivement, elle propose une boisson au goût très différent des sakés de l’année, souvent avec un certain fumet.
Inspirée des pratiques occidentales de vieillissement du vin en fût de chêne, il existe une variante au Koshu, nommée « Taru », du nom des tonneaux de saké en cèdre dans lesquels on a l’habitude de stocker le nihonshu. Vous l’aurez compris, un saké « taru » a simplement vieilli dans un de ces tonneaux.
Brasser un bon nihonshu est tout un art laissé aux maîtres brasseurs. Du polissage du riz à la mise en bouteille, chaque étape joue un rôle crucial sur le rendu final d’un bon saké. Le saké japonais, avec ses variétés et ses traditions, offre une palette de goûts et d’expériences. Que vous choisissiez un « Junmai » pur, un « Genshu » intense, un « Ginjo » raffiné, ou un « Koshu » vieilli, chaque gorgée vous transportera dans un voyage culturel et gustatif à travers le Japon. Et si vous souhaitez comparer les différents aspects aromatiques de chaque nihonshu, sachez qu’il existe des coffrets “découverte du saké” proposés par la brasserie Tajine Shuzo.
Découverte du saké japonais partie 3 : guide de dégustation et d’accord mets/saké -->